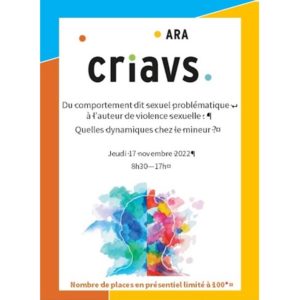Colloque en Ile de France « Vide de la pensée, banalité du mal et barbarie »
Le vendredi 12 mai 2017 8h30ARGUMENTAIRE :
Le psychiatre, à la suite de Karl Jaspers, maître d’Hannah Arendt, peut-il mêler
sa voix au débat actuel sur la banalité du mal ?
La réponse est positive, avec des arguments historiques, psycho-dynamiques et
médico-légaux, notamment, puisés à la clinique des tueurs de masse, des délinquants
sexuels, des tueurs en série, des terroristes.
L’antienne de la théorie situationnelle doit être corrigée à la lumière même de ce dont
Hannah Arendt a eu l’intuition : le vide de la pensée, condition du mal, ce que la clinique
de la seconde partie du XXème siècle a appris à décrire en terme de pensée opératoire,
de carence élaborative ou d’alexithymie.
Hannah Arendt a saisi toute l’importance du rapport entre l’absence de mentalisation
et l’action criminelle.
Ainsi, peut-on sortir du balancement entre la démonisation, «ce sont des monstres»
et la généralisation «tout le monde peut le faire dans certaines circonstances».
La barbarie des hommes ordinaires ne doit pas nous conduire à confondre
banalité et généralité du mal.
C’est sur ce thème, hélas éclairé par l’actualité, que nous vous invitons à venir
réfléchir et à débattre avec des cliniciens, des philosophes, des historiens, des juristes
au cours de cette journée d’étude.
Inscriptions obligatoires – Télécharger le formulaire d’inscription ici
Télécharger le programme complet ici
Lieu : Bourse départementale du travail 1, place de la Libération 93000 Bobigny secrétariat : 01 43 09 31 06 I